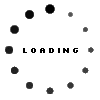8e Microfestival du Film ( 10 – 12 novembre 2013 )
Pour garder une trace de cette deuxième partie de l’ hommage rendu par PMH au cinéaste Jean-Christian Riff ( « Sur les pas de Jean-Christian Riff – écrire, photographier, filmer ») ce beau texte de Cathrine Goffaux « Jean-Christian – de sa bibliothèque à son jardin (et retour) » , présenté à la Halle le 11 novembre 2023 .
Un texte qui montre les ponts interdisciplinaires que Jean-Christian a su bâtir dans son travail entre litérature et cinéma sans oublier la photographie.
———————————————————————————–
«Jean-Christian de sa bibliothèque à son jardin (et retour) »
Le 17 mars 2020 Jean-Christian m’a envoyé son Journal du jardin. Corriger un texte est une occupation formidable par temps de confinement, donc de solitude, car inspecter un texte au plus près, c’est être en compagnie de son auteur.
Au printemps de cette année-ci, Dominique Degnieau m’a confié une clé USB de la dernière version du Journal du jardin, qu’il me fallait relire attentivement pour pouvoir vous le présenter aujourd’hui. Elle m’a aussi confié une vingtaine de livres qui avaient nourri Jean-Christian et son écriture.
J’espère, dans cette présentation, ne pas faire d’erreur d’interprétation comme le firent ces historiens qui glosèrent le « Rien » qu’avait inscrit Louis XVI sur son Journal le 14 juillet 1789, alors que le roi parlait de son tableau de chasse de ce jour-là.
Le Journal du jardin fait 267 pages, il a été écrit entre le 13 septembre 1995 et le 1er janvier 2000, donc à une époque où le brûlage des déchets verts n’était pas interdit. Le jardin en question, le premier jardin de Jean-Christian, était situé à La Bégude-de-Mazenc ; au loin, les falaises blanches d’Eyzahut, les deux collines d’Aleyrac, au sud, la crête des Monges. Le jardin comprenait un verger, dit verger de La Manotière.
Jean-Christian constellait souvent les marges de ses livres préférés de croix, de traits ou de triangles ressemblant au panneau routier « Danger ! », le tout dessiné avec un crayon à la mine épaisse. Tous ses livres sont parsemés de bouts de papier déchirés à la hâte en guise de marque-page sur lesquels, d’une écriture illisible, il notait un mot-clé, le titre abrégé de l’un de ses films, ou, le plus souvent, le mot « Jardin » pour Journal du jardin. Certains livres contiennent les articles publiés au moment de leur parution. Les pages sont cornées, les dos, cassés, les tranches, maculées. Ils ont vécu. Toutes ces lectures ont donc bien été fondatrices de la rédaction du Journal du Jardin.
Les livres en question sont tous des essais, écrits par des auteurs dont la pensée est à la limite entre le théorique et le poétique.
L’auteur le plus représenté dans cette petite collection est Georges Didi-Huberman. Didi-Huberman publie depuis 1985 chez Minuit, c’est un philosophe de l’image et des arts visuels, il n’est pas dans l’érudition pure, c’est un passeur, il commente et décante diverses œuvres, y compris littéraires. Il s’appuie sur d’autres, comme Jean-Christian s’est peut-être appuyé sur lui… aussi je me permets de faire l’hypothèse que, des années durant, Jean-Christian a choisi les auteurs qu’il a lus en s’inspirant des choix de Didi-Huberman.
Dans le Journal, Jean-Christian pille ces auteurs ouvertement et entre guillemets, ou bien il se les approprie, tronque, altère leurs trouvailles en les adaptant à ses propres phrases. Mais il cite presque toujours ses sources. Certes, en ne livrant que les initiales. C’est ainsi que le mercredi 14 avril 1999, se côtoient dans un très long paragraphe G.B., J.-L.N., M.B., G.A., Y.K., K.M. Moi, C.G., je viens de vous le dire façon J.-C.R. Il fallait entendre Gaston Bachelard, Jean-Luc Nancy, Maurice Blanchot, Giorgio Agamben, le peintre Yves Klein. Tous appartiennent au panthéon riffien. Et K.M. ? Katherine Mansfield ? Non. Jean-Christian devait lire peu d’œuvres de fiction. La mention après K.M. d’un essai intitulé « Du désœuvrement comme vérité effective de l’homme » résout la devinette : K.M., c’est Karl Marx. Jean-Christian admet qu’il fait « le malin avec [ses] citations ». En usant de ce principe méthodologique, il lui est arrivé de ne plus savoir distinguer ce qui lui appartenait vraiment et ce qui appartenait à l’auteur qu’il était en train de lire, et contrairement à Wittgenstein qu’indifférait le fait que quelqu’un ait pensé la même chose que lui avant lui, Jean-Christian avoue n’y être pas vraiment indifférent.
Une cinquantaine d’auteurs sont présents dans le Journal du jardin dont certains réapparaissent constamment (Rilke, Nietzsche, Walter Benjamin, n’allez pas en déduire que la culture germanique y soit majoritaire), plusieurs peintres, quelques personnages mythologiques, un chanteur grunge, David Bowie et Tintin, Georges Perec à trois reprises, deux titres de film, La Prisonnière du désert et Vol au-dessus d’un nid de coucou, et trois cinéastes.
Parce que les civilisations orientales ont été les premières à avoir pensé le paysage et le jardin, Jean-Christian reproduit également des haïkus. Volontiers polémique, il considère que beaucoup de bêtises ont été dites à leur sujet, que le haïku révèle plus une béance entre l’être et son environnement qu’une harmonie, qu’il n’y aurait pas de haïku heureux. Des préceptes zen figurent aussi dans le Journal, bien que Jean-Christian déclare ne se livrer à aucun exercice méditatif.
La temporalité des « entrées » du Journal est tout à fait irrégulière, ainsi que la longueur de chacune. Jean-Christian, en se livrant au jeu des relectures incessantes entre 2000 et 2015, gardait apparemment les états successifs de son texte, opérait des retraits ou des ajouts, brouillait les repères chronologiques. Ces allers et retours font du Journal un journal-palimpseste plein de « rétractations » au sens où l’entendait saint Augustin, non dans celui de démentir ou de renier mais dans le sens de « traiter à nouveau ». Dans son exemplaire de Là où le cœur attend de Frédéric Boyer lu en 2017 se trouve un papier sur lequel Jean-Christian a écrit « Revoir 1998 ». Autre preuve matérielle de son esthétique du tâtonnement : les paragraphes qu’il a laissés en bleu ou en rouge et qu’il devait envisager de « réviser ». Sa pensée se corrigeait et s’affinait au fil du temps et des lectures. Par delà les paradoxes, et même les apories, elle demeure très cohérente, comme l’est son œuvre cinématographique, dont il faut rappeler qu’elle ne démarra vraiment qu’au début des années 2000, hormis Printemps, le journal filmé d’un séjour de huit jours dans le paysage de son enfance, à Bogève en Haute-Savoie. Par delà les emprunts, les influences, les rétractations, l’ipséité – ce qui fait qu’une personne est unique et absolument distincte d’une autre – l’ipséité de Jean-Christian est indéniable.
Ainsi que l’on peut s’y attendre, il prenait régulièrement la résolution – jamais tenue – d’arrêter son Journal.
Jean-Christian pratique une adresse constante à son lecteur supposé pour instituer une complicité, voire un semblant de collaboration avec lui. Il va même jusqu’à employer un « nous », puisque souvent cette adresse se double d’une adresse à lui-même. Il s’agit de s’inciter et de l’inciter constamment à continuer, soit continuer à regarder le jardin, soit continuer à lire, et continuer à écrire pour ce qui le concerne. Il craint qu’un lecteur désabusé ne dise, « Je vois le genre », et laisse tomber. Bien conscient qu’il met à l’épreuve sa patience, il use de prolepses, cette figure de rhétorique par laquelle on va au-devant des objections… et s’en amuse.
Une image, appelée « image première » dès la page 9, aurait originé l’écriture du Journal. Elle n’a cessé de trembler, s’évanouir et revenir. Il l’a recherchée à partir du mitan de sa vie et pendant vingt ans, s’abandonnant à cette passion dans une course sans fin qu’il avait raison de nommer une méthode, puisque seule la recherche de cette sorte d’image sacrée dotée d’un pouvoir spirituel comptait. Après avoir imaginé qu’elle pourrait représenter une femme ou un lieu utopique, qu’elle pourrait être très ancienne et structurelle, il l’a traquée jusque dans le plus insignifiant : herbes, feuillages, dans le plus fugace : nuages, martinets et hirondelles et dans le plus évanescent : la lumière. Son but était de parvenir à la nommer.
« J’étais comme celui qui se ressent
d’une vision oubliée et qui s’ingénie
en vain à se la remettre en mémoire » (ce n’est pas du Jean-Christian, c’est dans La Divine Comédie).
Jean-Christian a puisé chez Bachelard l’idée que la contemplation est, en nous, une puissance créatrice, et chez Agamben, reprenant Aristote, l’idée que celui qui possède une puissance peut aussi bien la mettre en acte que ne pas la mettre en acte. Il en tire la force de supporter les journées où il ne se passe « rien » – rien au tableau de chasse –, et de railler sa capacité de désœuvrement, sa pratique de l’écriture pour « meubler le temps », les moments où [il] « tourne en rond pour écrire qu'[il] tourne en rond ». Le 17 novembre 2000, il renchérit avec une citation de Blanchot, « Celui qui ne fait rien de sa vie, écrit qu’il ne fait rien et voilà tout de même quelque chose de fait. »
Cependant, il lui arrivait de s’activer dans l’indescriptible fouillis qu’avait été ce jardin : il désherbait, éclaircissait la rangée de rosiers, bêchait autour des groseilliers, relevait une haie de buis, cueillait les fruits, réaménageait le potager.
Comme Gustave Flaubert, Jean-Christian pensait que pour qu’une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps. Aussi observait-il inlassablement la vie mystérieuse, chimique et alchimique des plantes. Il eut le bon goût d’éviter tout discours écologique. Comme Francis Ponge, il savait que pour écrire, il faut relever le défi que les choses posent au langage. Le verger, le paysage, le ciel, la lumière lui posaient suffisamment de défis pour qu’il n’éprouvât pas l’envie de sortir du jardin, respectant en cela l’idée de clôture prééminente dans l’étymologie du mot « jardin ». La tempête qui les dimanche 26 et lundi 27 décembre 1999 détruisit tant d’arbres en France est plus ou moins la seule mention du monde extérieur… sans doute parce qu’il avait dû craindre que son jardin n’en souffrît.
Que signifiait regarder pour Jean-Christian ? Si chez lui la vue prévalait sur les autres sens, c’est qu’elle ouvre l’éventail de la différence, et qu’elle le mettait, par ce travail de la distinction, sur la voie de la connaissance. C’est pourquoi son expérience du jardin, plus qu’une affaire de « vue », fut une affaire du « vivre ». Expérience redoublée par l’exercice de la photographie, qu’il pratiquait comme un facteur de révélation, comme une puissance d’éveil. Il écrit, « Je ne recherchais pas l’image fixée, mais une visée, une sensation, une démarche, une approche » . Ce qui l’amena, par exemple, à prendre 400 vues de ses 48 roses trémières, ces roses rustiques que, comme Philippe Jaccottet, il préférait de beaucoup aux roses à nom ronflant. Elles incarnaient plus que ces dernières les vers d’Angelus Silesius, « La rose est sans pourquoi / elle fleurit parce qu’elle fleurit / elle n’a souci d’elle-même, ne demande pas si on la voit »… les roses trémières avec leur caractère tonique d’espérance légère.
En mai 1998 une partie du jardin a été mise en vente par sa propriétaire. Le ton change, on sent qu’il va y avoir du mouvement et de l’action. Le récit de l’arrivée des futurs occupants, de la destruction du verger et de la construction d’une maison Vestale se déploie au fil d’entrées beaucoup plus longues et anecdotiques, sans que Jean-Christian renonce aux notes brèves, aux associations d’idées, aux aphorismes, aux allitérations, aux apostilles, aux jeux de mots, à la tentation de faire sonner les rimes, au lexique du cinéma. Toute une bande de personnes contre lesquelles Jean-Christian exerce son ironie se met à peupler le Journal et lui inspire quelques scènes de genre.
Le petit pommier, qui avait déjà été abondamment photographié, désormais coupé et réduit en cendres, acquit alors le statut de possible « image première », et Jean-Christian s’était mis à effectuer des raids en terre étrangère pour photographier son emplacement. Des pages entières racontent le comptage systématique du nombre de ses pas et le comptage de ses séries de prises de vue. Il s’imposait les règles strictes d’un véritable cahier des charges, et, en cela encore, le chemin qui conduit au but, la méthode semblent plus importants que le but. La plus cadencée de ces pages raconte comment il rechargeait à toute vitesse de la pellicule dans son appareil – c’était au temps de l’argentique. On se prend à regretter qu’il n’ait pas davantage écrit dans cette veine-là, où il se montre très talentueux.
Il n’a jamais fait développer ces photographies. Comme il n’a jamais exhumé les 117 carnets d’un premier Journal commencé en 1981.
Le caractère à la fois fugitif et cyclique de tout événement dans le jardin amenait Jean-Christian à penser sans cesse au cours du temps vécu comme flexible et inexorable. D’un naturel inquiet, il s’admoneste à l’orée de ses 40 ans – « il serait temps de… » – et quand il les atteint, le 22 octobre 1995, il manifeste de l’effroi. Pas moins. La question « Comment poursuivre ? », qu’il ne pose pas, devait souvent lui traverser l’esprit. Et il ne reculait pas devant les interrogations existentielles que sont le sens de la vie et la mort – dont il recommande de faire l’expérience, « c’est un peu contraignant, écrit-il, je vous l’accorde, mais ce n’est pas pire que prier chaque jour, ou faire vingt minutes de yoga ».
Comme toutes les personnes inquiètes, lucides et bien élevées, Jean-Christian ne manquait pas d’humour : énervé par la hantise de la page blanche qu’expriment beaucoup d’auteurs, Jean-Christian en offre une à son supposé lecteur, Oui, un recto vierge, et au verso, « Vous voyez, c’est pas terrible, on s’en remet. » Il se sermonne quand il se voit flirter avec une poésie rabâchée, des clichés rebattus, quand lui arrivent des mots excessifs, comme « parcours initiatique », mais il s’autorise l’usage du mot « concept ». Il n’hésite pas à raconter une scène où il s’est montré très ridicule… et que je tairai. Il félicite Dieu, le Très Grand Directeur de la Photographie, pour un coucher de soleil Style Vistavision, Technicolor, fin des années 1950. Il compare les jeux entre le lapin, la taupe et lui-même (« creuser, reboucher ») au « bricolage » entre lui-même, le TGDP et le lecteur. Il force la note quand il calcule le nombre de mauvaises herbes arrachées : 180 000 entre 15 et 18 heures le 7 octobre.
Aucune des versions d’un Journal n’est « le texte » parce que celui-ci se présente comme un processus potentiellement infini, et particulièrement dans le cas de Jean-Christian. Avait-il vraiment mis un terme définitif à son écriture alors qu’une note écrite par lui dit que le Journal « ne s’achèverait qu’à sa mort » ?
Que penser de sa fin, cet épilogue qui raconte un épisode forcément fictif qu’il conclut malicieusement par un « J’ai l’air fin » ? F I N.
Le destin d’un Journal « à soi », pour reprendre l’expression de Philippe Lejeune, le théoricien du genre, est de ne rester « qu’à soi ». Jean-Christian souhaitait-il que le sien soit publié ? Le mot « livre » qu’il emploie à son propos p. 58 a-t-il valeur de lapsus calami ou non ? Qu’entendait-il en écrivant dans la même note que le Journal « pourrait être lu au hasard » ? Comme les œuvres d’art, les Journaux intimes d’autrefois n’existaient qu’en un seul exemplaire. Jean-Christian, qui avait composé le sien sur ordinateur et l’avait fair lire à quelques amis, souhaitait-il qu’il soit reproduit ? Qu’il circule ?
Impossible de répondre à sa place. Jean-Christian n’aimait pas que l’on fît parler les morts.
Un seul élément de réponse, infime : lui qui a fait du mot « verger » l’un des mots-clés de son texte s’imagine le lisant pour le public du verger Urbain V à Avignon.
Le mot intime est presque toujours accolé au mot Journal dans les analyses qui portent sur ce type d’écrits. Selon ses propres mots, Jean-Christian a toujours cherché à éviter les intrusions directes de l’intime dans son texte, tout en reconnaissant que l’intime affleure, car lui-même « n’arrête pas de rentrer dans le champ » (encore une expression empruntée au vocabulaire du cinéma). Il existe un troisième Journal écrit par Jean-Christian, intitulé « État des lieux », c’est un projet de film dont le déroulement sur cinq mois retrace la façon dont il a dû vider une maison qu’il devait quitter. Dans celui-là, Dominique est absente. Dans le Journal du jardin, le jardin a beau être très peu « habité » jusqu’à l’intrusion des futurs voisins, on croise régulièrement Dominique et son fils Nicolas. Eux aussi ne sont désignés que par leurs initiales respectives. Le samedi 1er janvier 2000, Jean-Christian note, « j’aperçois D. qui herborise dans son ‘jardin secret’, la même émotion surgit, faite d’un amour profond ». Mais je trahirais Jean-Christian en oubliant de dire qu’il exprime aussi dans le Journal son affection pour son arrière-grand-père mort à Verdun en 1916, pour sa grand-mère et pour sa mère.
Permettez-moi de remercier Dominique, Chantal, Christophe, l’association PMH pour m’avoir permis de marcher avec eux sur les pas de Jean-Christian.
Catherine Goffaux
«Sur les pas de Jean-Christian Riff», 8ème Micro-Festival du film de Dieulefit organisé par P.M.H. (Patrimoine-Mémoire-Histoire), Dieulefit, 10 au 12 novembre 2023.



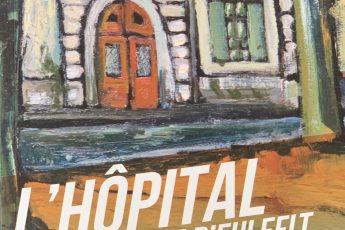
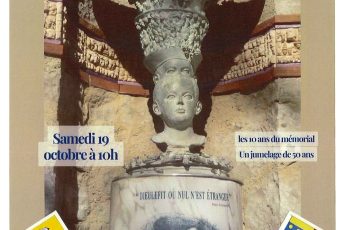
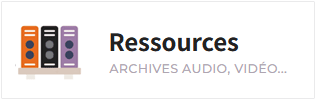
 L' association PMH Dieulefit a pour objectif de conserver le patrimoine dit "invisible", de recueillir, de sauvegarder et de mettre en valeur la mémoire du Pays de Dieulefit...
L' association PMH Dieulefit a pour objectif de conserver le patrimoine dit "invisible", de recueillir, de sauvegarder et de mettre en valeur la mémoire du Pays de Dieulefit...